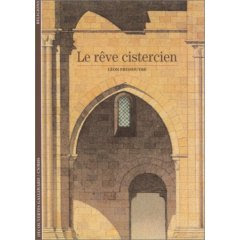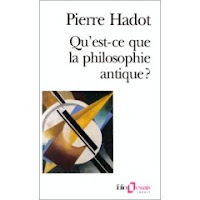L'exposition du musée de l'Orangerie suscite chez celui qui la visite un sentiment mêlé : c'est d'abord (i) la grande satisfaction de voir ou revoir quelques superbes tableaux, et tout particulièrement ceux de Georges de La Tour, dont beaucoup ont fait le déplacement depuis Nantes, Berlin, ou Le Louvre, mais aussi cette belle nature morte de Roger Rohner (1938), exposée dans la salle des consonnances, pas très loin de Balthus, Picasso, Hélion. A moins d'être fan des Frères le Nain, et d'autres respectables tâcherons du pinceau, on s'en tiendra là.
L'exposition du musée de l'Orangerie suscite chez celui qui la visite un sentiment mêlé : c'est d'abord (i) la grande satisfaction de voir ou revoir quelques superbes tableaux, et tout particulièrement ceux de Georges de La Tour, dont beaucoup ont fait le déplacement depuis Nantes, Berlin, ou Le Louvre, mais aussi cette belle nature morte de Roger Rohner (1938), exposée dans la salle des consonnances, pas très loin de Balthus, Picasso, Hélion. A moins d'être fan des Frères le Nain, et d'autres respectables tâcherons du pinceau, on s'en tiendra là. C'est ensuite (ii) le propos même de l'exposition. Ce qui est exposé ici, ce n'est pas "la réalité", ni même des "tableaux de peintres de la réalité". Pas du tout. Le sujet de l'expoition, c'est... l'exposition elle-même, où plutôt celle organisée en 1934 et qui a laissé un souvenir très fort chez tous ceux qui ont eu le privilège de la voir. C'est là que René Char découvre La Madeleine pénitente, là aussi que Jean Hélion s'interroge sur la notion de réalisme et de peinture figurative. Il n'est pas rare de trouver des allusions à l'exposition de 34 dans les biographies ou les parcours artistiques des intellectuels de l'époque. En cela, l'exposition est peut-être aussi célèbre que celle de l'Armory Show de 1913 à New York, dans un tout autre registre. Le musée de l'Orangerie vient d'ouvrir, et célèbre donc sa propre mémoire, se prend lui-même pour le principal sujet de son programme d'exposition. Ce principe de la mise en abîme est un signe du temps : pays lourd de son passé, qui aime à le chérir, à le scruter, pour se glorifier ou se repentir. Lorsqu'une démarche culturelle, qu'elle quelle soit, atteint le stade de la maturité, elle se prend elle-même pour son propre objet. La littérature le fait depuis longtemps, au moins depuis Don Quichotte, le cinéma aussi, par exemple dans Pulp Fiction, grouillant de références à l'art cinématographique. Par parenthèse, et chose curieuse, dans les séries américaines, ce mécanisme de l'auto-référence est souvent utilisé comme un "effet de réel" justement, le signe d'une distance prise par rapport à la fiction. Tel héros de film catastrophe pourra signifier la gravité d'une situation par quelques mots biens choisis : "Putain John, revient sur terre, on n'est pas dans une série télé ici, et je suis pas Mc Gyver ! on s'en sortira jamais !" etc. etc.
C'est ensuite (ii) le propos même de l'exposition. Ce qui est exposé ici, ce n'est pas "la réalité", ni même des "tableaux de peintres de la réalité". Pas du tout. Le sujet de l'expoition, c'est... l'exposition elle-même, où plutôt celle organisée en 1934 et qui a laissé un souvenir très fort chez tous ceux qui ont eu le privilège de la voir. C'est là que René Char découvre La Madeleine pénitente, là aussi que Jean Hélion s'interroge sur la notion de réalisme et de peinture figurative. Il n'est pas rare de trouver des allusions à l'exposition de 34 dans les biographies ou les parcours artistiques des intellectuels de l'époque. En cela, l'exposition est peut-être aussi célèbre que celle de l'Armory Show de 1913 à New York, dans un tout autre registre. Le musée de l'Orangerie vient d'ouvrir, et célèbre donc sa propre mémoire, se prend lui-même pour le principal sujet de son programme d'exposition. Ce principe de la mise en abîme est un signe du temps : pays lourd de son passé, qui aime à le chérir, à le scruter, pour se glorifier ou se repentir. Lorsqu'une démarche culturelle, qu'elle quelle soit, atteint le stade de la maturité, elle se prend elle-même pour son propre objet. La littérature le fait depuis longtemps, au moins depuis Don Quichotte, le cinéma aussi, par exemple dans Pulp Fiction, grouillant de références à l'art cinématographique. Par parenthèse, et chose curieuse, dans les séries américaines, ce mécanisme de l'auto-référence est souvent utilisé comme un "effet de réel" justement, le signe d'une distance prise par rapport à la fiction. Tel héros de film catastrophe pourra signifier la gravité d'une situation par quelques mots biens choisis : "Putain John, revient sur terre, on n'est pas dans une série télé ici, et je suis pas Mc Gyver ! on s'en sortira jamais !" etc. etc.C'est donc au tour de la muséographie (ce n'est peut-être pas la première fois) de jouer ce jeu de la commémoration et de la mise en abîme. Soit. Admettons que ce n'est pas le moindre des ironies que ce soit justement un exposition consacrée aux "peintres de la réalité" qui serve de prétexte à cette célébration qui s'en affranchit au contraire.